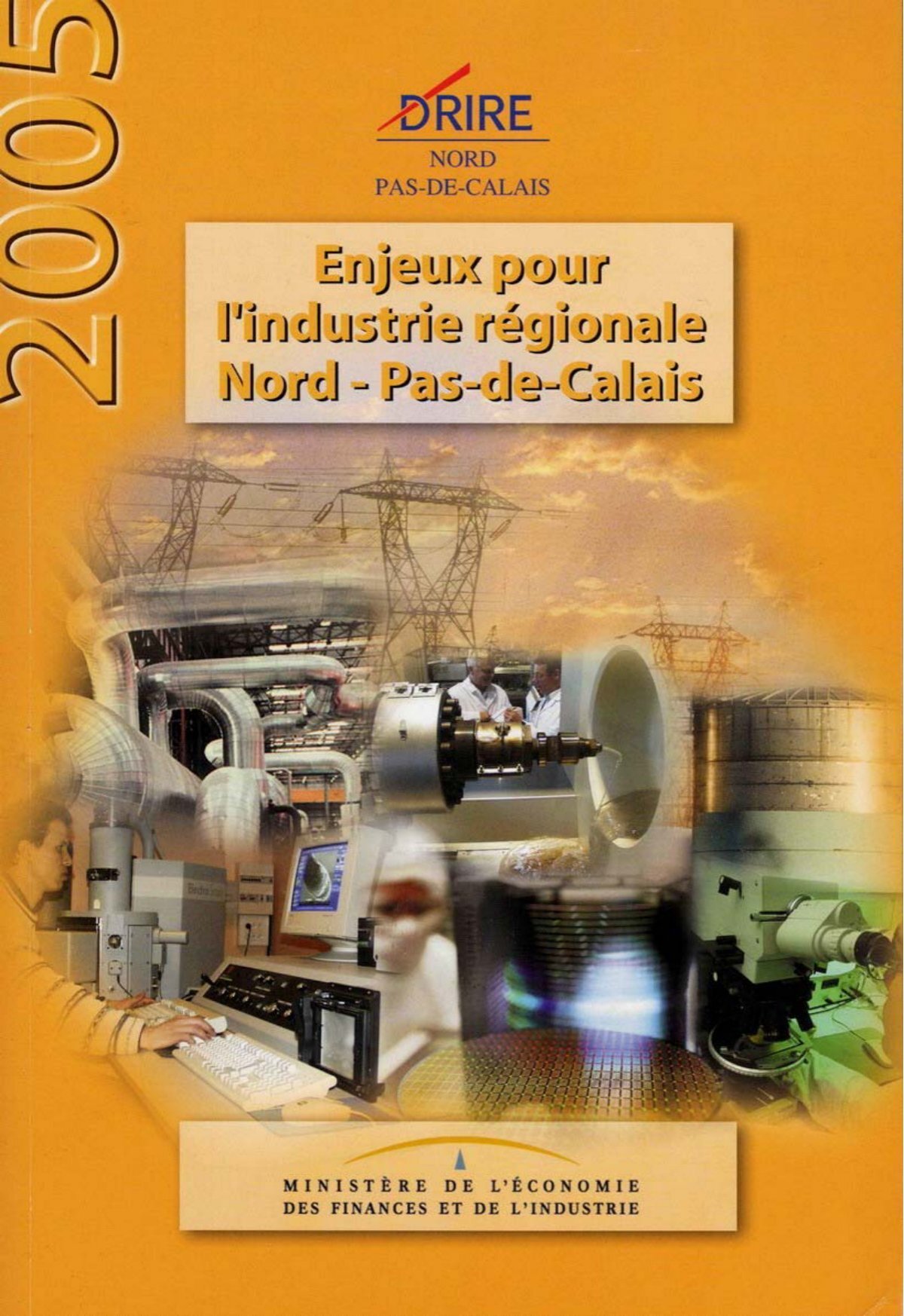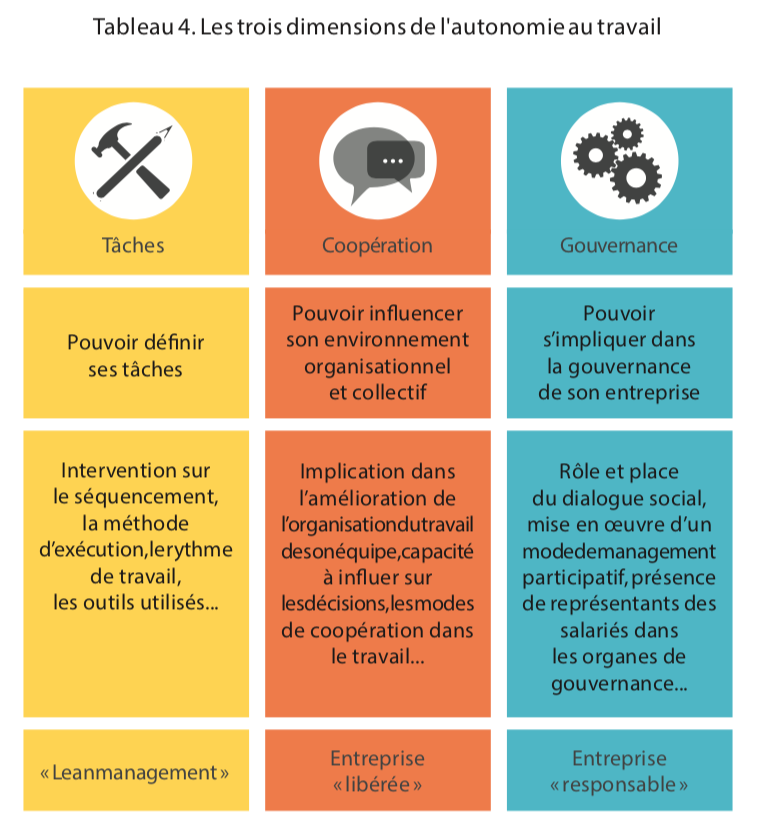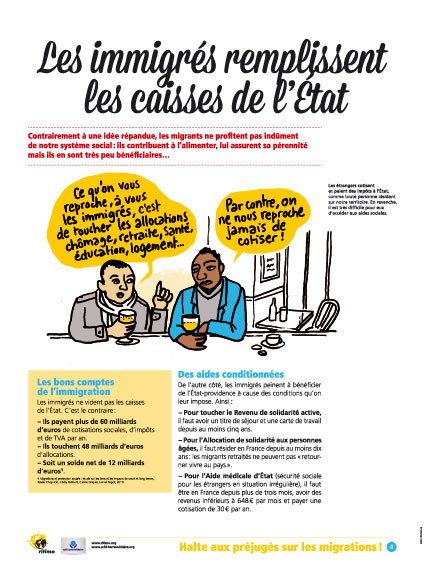L’influence de l’USAID : Entre « soft power » et « guerre hybride »
La décision récente de suspendre les activités de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) a provoqué un tollé dans le monde entier. Cette agence, créée en 1961, avait pour objectif de financer des projets de développement économique, d’action humanitaire et de promotion de la démocratie à travers le globe. Cependant, son rôle a évolué au fil des ans, et elle est devenue un outil clé de l’influence américaine dans les affaires internationales.
L’USAID a disposé d’un budget annuel considérable, qui a atteint 44 milliards de dollars en 2024. Cette manne financière a permis à l’agence de soutenir des milliers de projets et d’organisations à travers le monde, notamment dans les domaines de la presse et de la société civile. Cependant, cette générosité a également suscité des interrogations sur les motivations réelles derrière ces financements.
Certains ont accusé l’USAID de servir de vecteur pour la promotion des intérêts américains et de l’idéologie occidentale, plutôt que de véritablement soutenir le développement et la démocratie. Les exemples abondent : en Hongrie, les médias pro-UE ont reçu des fonds pour s’opposer au premier ministre Viktor Orban ; en Géorgie, les organisations de la société civile ont été financées pour combattre le gouvernement récemment reconduit ; et en Ukraine, une large partie de la presse a bénéficié de financements occidentaux, notamment américains.
La décision de suspendre les activités de l’USAID a donc provoqué un véritable séisme dans ces pays, où les organisations et les médias dépendaient fortement de ces financements. Les réactions ont été vives, avec des accusations de « guerre hybride » et de tentative de déstabilisation des régimes en place.
Cependant, il est intéressant de noter que lorsque l’USAID finançait ces organisations et médias, cela était considéré comme un exercice de « soft power », c’est-à-dire une forme d’influence douce et légitime. Mais si Moscou mettait en place un organisme similaire pour financer des médias français, par exemple, cela serait probablement dénoncé comme une attaque de « guerre hybride ».
Cette ambiguïté soulève des questions fondamentales sur la nature de l’influence internationale et les limites de la « soft power ». Est-ce que les pays ont le droit de financer des organisations et des médias à l’étranger pour promouvoir leurs intérêts, ou cela constitue-t-il une forme de manipulation et d’ingérence ? Les réponses à ces questions seront cruciales pour comprendre les enjeux de la géopolitique contemporaine.